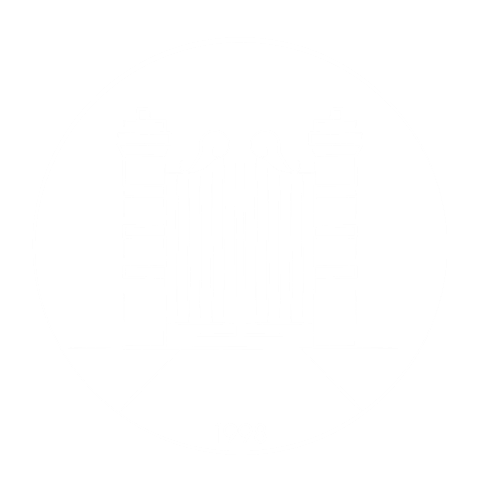Le rôle du juge dans la protection du patrimoine

Jean-Marc Février, professeur agrégé de droit public à l’Université de Perpignan-Via Domitia, avocat au Barreau de Narbonne.
En s’interrogeant sur le rôle du juge dans la protection du patrimoine, on peut examiner successivement les conditions de l’accès au juge (I), la décision de ce dernier (II) et son exécution (III).
I. Au titre du premier thème abordé, celui de l’accès au juge, on peut tout d’abord considérer que la formulation exacte devrait être la réduction de l’accès au juge. Sensible au lobbying intensif des professionnels de l’immobilier, les autorités normatives (pour ne pas viser le seul législateur mais bien y inclure le Conseil d’Etat) ont décidé de casser le thermomètre pour ne plus voir la fièvre. Si on reprend le problème à l’endroit, l’insécurité liée au contentieux de l’urbanisme vient d’abord de la complexité de ce droit et de l’incertitude qu’il génère sur la légalité des documents locaux et des autorisations d’urbanisme. Elle vient ensuite de l’excessive lenteur des juridictions administratives qui manquent de moyens pour faire face à l’afflux des requêtes, malgré l’amélioration de leur productivité (mot étrange en matière du justice) : les statistiques satisfaisantes ne sont que des moyennes et chacun sait que les dossiers complexes sont souvent plus lents à traiter. Au lieu de s’attaquer à ces deux racines du mal, il était plus simple de prendre prétexte de ces fameux recours abusifs, tellement abusifs que la juridiction civile ne les sanctionnait presque jamais… D’autant que personne n’a voulu regarder de plus près à la quantification de ce phénomène que les habitués de la matière s’accordent à considérer comme marginal. Mais il est vrai que pour un promoteur, tout recours est abusif. De là à ce que cette antienne soit reprise par les pouvoirs publics… Ainsi, pour faire face à ces fameux recours abusifs, les conditions de recevabilité des actions des associations ont été révisées dans un sens très restrictif (L. 600-1-1 c. urb., qui condamne en pratique les associations ad hoc), les conditions de recevabilité étant durcies de manière plus générale (à la fois sur l’intérêt à agir, avec l’article L. 600-1-2 c. urb., mais aussi sur le délai pour agir avec l’introduction de l’article R. 600-3 c. urb., sur ces problématiques, voir J.-M. Février, « « Le droit au juge à l’épreuve de l’évolution du contentieux de l’urbanisme, Avant-propos », JCP A, 2019, n° 2182).
Oubliant que le requérant, en excès de pouvoir, est un procureur de la légalité, selon la belle formule du doyen Hauriou, il s’agissait d’éviter surtout les phénomènes de mutualisation permettant de financer un contentieux au coût parfois important, d’adapter un intérêt à agir et de prémunir contre le chantage exercé contre le requérant. Haro donc sur le recours associatif, à l’exception de celui des associations agréées, pour des raisons qui ne sont pas étrangères à l’adoption consensuelle de la loi Grenelle I.
On peut revenir ici rapidement sur le terme de chantage exercé sur le requérant. Celui qu’il peut exercer sur le titulaire de l’autorisation d’urbanisme a été décrit à maintes reprises et il est bien sûr unanimement condamné. Mais personne n’a évoqué le chantage tout aussi classique exercé sur le requérant lui-même (à l’époque, la mise en demeure délivrée par huissier de justice au petit matin, aujourd’hui, les conclusions au titre de l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme). La pression mise sur le requérant (mais qui ne peut être exercée lorsque le requérant est une association), menacé par une demande indemnitaire gonflée comme un bodybuilder de compétition, peut l’amener, c’est humain, à douter de son avocat voire de sa propre motivation au point de se désister, alors même que son recours est potentiellement fondé en droit : la peur du risque, même statistiquement peu élevé, de devoir payer une somme considérable peut légitimement faire réfléchir ceux qui n’ont pas la connaissance technique ou les moyens de l’assumer. Cela arrive sans doute aussi souvent qu’un recours abusif. Lequel de ces deux chantages est le plus condamnable, même si l’un est désormais organisé par la loi ? Faire un recours sans fondement pour obtenir de l’argent ou détourner un requérant du juge pour éviter à ce dernier d’annuler un permis illégal ? Poser la question, c’est déjà y répondre. Un choix politique a été fait et conduit ouvertement à remettre en cause l’accès au juge…
Une décision administrative qui ne doit être annulée qu’en dernier recours
II. Le même choix politique se retrouve logiquement dans les décisions du juge administratif, dont le rôle est désormais d’œuvrer au maintien de la décision d’urbanisme, au besoin amendée. Là où les esprits naïfs considèrent que le juge doit être un tiers impartial, il est devenu dans le contentieux de l’urbanisme un acteur au service de la décision administrative qu’il ne doit annuler qu’en dernier recours, quand aucune autre solution n’existe. Le législateur a étendu les possibilités de régularisation déjà ouvertes par la jurisprudence (L. 600-5, L. 600-5-1, L. 600-9 c. urb., C.E., 9 décembre 1994, « SARL Séri », n°116447 puis C.E., 2 février 2004, « SCI Fontaine de Villiers », n° 238315), cette dernière n’étant pas en reste pour élargir encore le champ de la régularisation (en « débridant » par exemple le recours au permis modificatif, C.E., 26 juillet 2022, n° 437765).
Cela pose à l’évidence un problème politique au sens le plus large du terme et questionne non pas seulement sur la place du juge administratif mais plus généralement sur ce qu’est un juge. Le retour au juge administrateur se profile assez clairement mais derrière l’ivresse de l’action efficace, crédo très contemporain, le juge administratif risque d’y perdre la crédibilité qu’il a mis près de deux siècles à construire. Quand professionnels du droit et administrés auront compris que le contentieux de l’urbanisme est mort et ne sert plus à rien (sauf parfois à faire perdre du temps au constructeur) puisque tout est régularisable (ou presque), les citoyens se détourneront du juge… Est-ce souhaitable dans un Etat de droit de dire à un justiciable que son recours était fondé mais que la décision sera maintenue grâce à la régularisation et qu’il perd donc le procès (mais, dans sa grande mansuétude, le juge ne le condamnera pas aux frais irrépétibles) ? Allez expliquer à un gendarme qui vous demande votre permis de conduire que vous le lui porterez plus tard… Socialement, politiquement, le cadeau fait au monde de la construction risque d’avoir un coût qui peut s’avérer exorbitant (ce dont nombre de juges du fond ne manquent pas de s’émouvoir). Cela interroge aussi sur l’intérêt de l’inflation normative : à quoi bon détailler sans fin des procédures dont le non-respect n’est pas sanctionné in fine ? S’il existe des formalités non substantielles dont la méconnaissance est sans incidence, pourquoi alourdir ainsi le droit de l’urbanisme et ralentir le processus décisionnel ?
Une décision sans aucune conséquence ou presque
III. On en arrive enfin à l’exécution des jugements, question moins centrale finalement puisque l’office du juge est tourné vers le rejet des requêtes. Qu’on se rassure, le pétitionnaire qui conteste un refus peut obtenir une injonction tendant à la délivrance de l’autorisation sollicitée (C.E., avis, 25 mai 2018, n° 417350). La logique du système tend à ce que le juge administratif, à terme, instruise la demande du pétitionnaire et lui délivre au besoin directement l’autorisation sollicitée. Le recours pour excès de pouvoir s’efface devant le plein contentieux en droit de l’environnement, il n’y a pas de raison que le droit de l’urbanisme y échappe. Le juge administrateur, supérieur hiérarchique, est manifestement de retour, autant en profiter pleinement. Et lorsqu’il ne pourra pas faire autrement que d’annuler définitivement la décision d’urbanisme, nulle crainte, le législateur a pris les devants. En effet, l’article L. 480-13 du code de l’urbanisme a été progressivement réécrit pour limiter les risques de remise en état, la démolition de la construction édifiée sous couvert d’un permis illégal n’étant la règle que dans certains espaces limitativement énumérés (les périmètres de protection du patrimoine culturel ou naturel restant fort heureusement protégés). L’efficacité du juge administratif, dans ce cas précis, c’est en somme que sa décision n’ait aucune conséquence ou presque. Si on osait, on suggérerait de supprimer purement et simplement l’article L. 480-5 du code de l’urbanisme, qui donne au juge pénal la faculté d’imposer la remise en état suite au constat d’une infraction en matière d’urbanisme (les juridictions pénales étant souvent sensible à l’idée de remise en état). L’impunité serait alors totale et le contentieux de l’urbanisme devenu inutile. Mais, comme la nature a horreur du vide, il n’est pas exclu que se développerait alors une autre forme de régulation, parfois prisée dans une île de beauté…